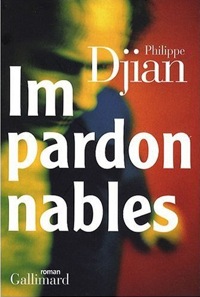 La preuve que je ne suis pas obtus, j’ai acheté le dernier roman de Philippe Djian, Impardonnables. Pis même, profitant d’un accès de bonne volonté, je l’ai lu.
La preuve que je ne suis pas obtus, j’ai acheté le dernier roman de Philippe Djian, Impardonnables. Pis même, profitant d’un accès de bonne volonté, je l’ai lu.
Je m’étais dit qu’il y avait nécessairement un motif, ayant forcément trait à la littérature, qui expliquait que cet homme-là était reçu sur tous les plateaux et dans toutes les émissions, qui justifiait que son dernier ouvrage reçoive un accueil si unanimement positif à travers tout ce que le microcosme médiatique compte de critiques littéraires.
Je ne vais pas épiloguer sur les motifs, qui de toute évidence n’ont que peu à voir avec la qualité littéraire de l’objet, le fait est que je me suis fait piéger. Une fois de plus. L’avantage est que 230 pages imprimées en gros caractères, ça se lit vite. Malheureusement, et c’est une sorte de prouesse, on parvient tout de même à trouver le temps long.
Tout est dans l’absence de style – ce style dont à juste titre Djian fait dire à son personnage narrateur qu’il est « le moteur de cette folie » que constitue toute entreprise littéraire. Or il n’y a pas ici ce souffle que seul le style est à même d’insuffler à une oeuvre. C’est que l’écriture de Djian est à la littérature ce que le surimi est à la gastronomie : un met conçu pour plaire au plus grand nombre, inconsistant et sans saveur, pas tout à fait indigeste, mais qui vous laisse au seuil de l’écoeurement ; et qui en aucune façon ne saurait vous nourrir, encore moins vous extasier.
Et l’histoire ? Celle d’un vieil homme, écrivain sur le retour, ni sympathique ni complètement antipathique, plus aigri que pessimiste, pas vraiment anti-héro. Pas vraiment un vieil homme non plus en vérité – il a la soixantaine -, juste un vieux con comme il en existe à tout âge. Celui-ci a vécu une tragédie, quinze ans plus tôt, mais ça n’explique rien et d’ailleurs on s’en fiche un peu : voici donc juste un vieux con qui a perdu sa femme et une de ses filles dans un accident de voiture. So what ? Quinze ans plus tard, il fait la gueule à sa seconde fille parce qu’elle lui a fait un sale coup, pendant que le jeune homme déjanté – seul personnage un peu consistant du livre – qu’il a engagé pour suivre sa femme et lui apporter la preuve de son infidélité, devient l’amant de cette dernière. A la fin, ça se termine mal – ou du moins, c’est ce qu’on croit devoir comprendre.
Ce dernier épisode – quand le détective se révèle l’amant – est censé, du moins j’imagine, constituer un des, sinon l’unique rebondissement du roman, le ressort romanesque de l’histoire. Mais cela aussi est raté, et c’est le roman tout entier qui en vérité est cousu de fil blanc. A entendre Philippe Djian s’exprimer à travers la voix de son narrateur, on comprend que pour lui une des qualités qui font les grands écrivains est en leur capacité à être « rusé », « malin ». C’est sans doute vrai. Encore faut-il l’être suffisamment pour savoir également dissimuler les trucs qui ont été utilisés. Afin que l’ensemble sonne juste et émerveille.
Dans le roman de Philippe Djian, tout est transparent. On ne se dit pas, émerveillé : il y a forcément un truc. Non, on le voit – le truc – et c’en est désespérant. On les voit tous, sans exception, tous les jeux de miroirs, tous les artifices, toutes les ficelles. Et de fait, tout tombe plat, même l’humour – ce qui en devient tragique. On se retrouve comme devant un illusionniste qui a manqué un tour après l’autre au long de son spectacle, c’est-à-dire affligé. Un peu gêné aussi.
Affligeant, oui, c’est le mot. Comme on s’est laissé prendre une fois de plus, une fois de trop, à mordre dans un bâton de surimi. On le savait, pourtant.
|
|
Source : Djian ou le roman surimi |